Déclarer ses cryptomonnaies reste un parcours piégeux. La moindre approximation fait grimper l’impôt, ajoute des pénalités et déclenche des demandes de justificatifs. L’objectif de ce guide est simple. Éviter les erreurs récurrentes qui coûtent cher aux investisseurs crypto en France. Texte clair, exemples concrets, encarts pratiques. Tu trouveras des modules pour simuler l’impact d’une omission, vérifier tes obligations et préparer des preuves en cas de contrôle. Ce contenu est informatif. Il ne remplace pas un conseil fiscal personnalisé.
Oublier de déclarer ses comptes crypto à l’étranger
C’est l’erreur la plus chère. Un résident fiscal français doit déclarer chaque compte ou service crypto tenu à l’étranger. On parle des plateformes d’échange et de conservation, même si le solde est nul. Exemple courant : compte ouvert, jamais utilisé, jamais déclaré. Le formulaire à viser : 3916‑bis. Une déclaration par plateforme. À faire chaque année pour les comptes ouverts, utilisés, fermés pendant l’année.
Les portefeuilles non‑custodial (wallet perso avec clés privées) ne sont en général pas assimilés à un compte étranger. Ce sont les comptes tenus par un tiers qui posent enjeu.
Le risque est une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € par compte non déclaré, avec majorations éventuelles. Le coût dépasse vite la plus‑value imposable.
Comptes crypto étrangers non déclarés
Obligation annuelle de déclaration via 3916-bis. Le risque monte vite quand plusieurs plateformes sont oubliées.
Comment régulariser sans stress
Rassemble les informations d’ouverture, d’usage et de fermeture. Note le nom légal du service, le pays, l’identifiant de compte, la date d’ouverture. Complète la 3916‑bis depuis ton espace fiscal. Vérifie que l’année concernée est la bonne. Conserve des preuves : e‑mails d’ouverture, captures de l’onglet KYC, facture d’achat, relevés. En cas d’oubli sur une année passée, la régularisation proactive limite les risques.
Déclarer ses comptes étrangers ne rapporte pas d’impôt supplémentaire en soi. L’oubli, lui, coûte vite plusieurs milliers d’euros. Une heure de mise à jour protège une année entière.
Confondre cessions crypto-fiat et échanges crypto-crypto
La fiscalité française vise les cessions à titre onéreux. Vendre des cryptos contre euros ou payer un bien avec des cryptos entre dans ce cadre. Un échange crypto-crypto n’entre pas dans l’assiette de l’impôt pour un particulier non professionnel. Un simple transfert entre wallets n’est pas une cession.
L’erreur naît souvent d’un mix d’opérations sur l’année. On vend un peu d’ETH contre euros, on swappe du SOL contre BTC, on recharge une carte crypto qui convertit au paiement. Résultat : on déclare tout ou on ne déclare rien. Dans les deux cas on se trompe et l’ardoise grimpe.
| Opération | Statut fiscal | Détails |
|---|---|---|
| Vente de crypto contre euros | Imposable | Entre dans les cessions à titre onéreux. Plus-value calculée au prorata du portefeuille global. |
| Dépense d’une crypto pour un bien ou un service | Imposable | Assimilé à une vente. Prix du bien = prix de cession. |
| Conversion automatique via carte crypto au paiement | Imposable | Chaque transaction déclenche une cession. À tracer comme une vente. |
| Total annuel des cessions > 305 € | Imposable | Au-dessus du seuil, déclaration de la plus-value. En-dessous, exonération annuelle. |
| Échange crypto ↔ crypto au sein du portefeuille | Non imposable | Pas de sortie vers fiat ni achat d’un bien. Impacte seulement la valeur du portefeuille. |
| Transfert entre comptes ou wallets du même titulaire | Non imposable | Mouvement patrimonial sans cession. Conserver l’historique pour la traçabilité. |
| Achat de stablecoin contre crypto sans conversion en euros | Non imposable | Pas d’imposition tant qu’il n’y a pas vente en fiat ou paiement d’un bien. |
Contenu informatif. La situation peut varier selon votre profil fiscal.
Exemple clair avec méthode du portefeuille global
Tu as investi 7 000 € au total dans tes cryptos.
La valeur de marché de l’ensemble du portefeuille atteint 10 000 €.
Tu vends 2 000 € de BTC contre euros.
Coût d’acquisition affecté à la vente
7 000 × (2 000 ÷ 10 000) = 1 400 €.
Plus-value imposable sur la cession
2 000 − 1 400 = 600 €.
Si tes cessions totales de l’année restent à 300 €, aucune imposition. Si tes cessions totales atteignent 2 300 €, tu déclares la plus-value calculée, avec le PFU 30 % en principe, sauf option globale pour le barème.
Simuler la plus-value estimée
Outil pédagogique. Hors frais et cas particuliers.
Prêt à calculer. Saisis tes valeurs puis clique sur Calculer.
Points de vigilance
Les frais réduisent la plus-value. Intègre les frais d’achat au coût d’acquisition et les frais de vente au prix de cession. Les cartes crypto convertissent souvent en euros à chaque passage. Chaque paiement devient une cession. Les swaps à répétition ne sont pas imposables, mais ils modifient la valeur totale du portefeuille utilisée dans le prorata. Garde une trace des valorisations à chaque cession en euros.
Bonnes pratiques
Réduire le risque d’erreur. Être prêt en cas de contrôle.
Choisir à l’aveugle entre PFU et barème progressif
Beaucoup cochent par défaut le PFU sans vérifier leur situation, tandis que d’autres basculent vers le barème progressif en pensant économiser alors que l’addition grimpe. Le bon choix dépend de ta tranche marginale, du montant de tes gains, des moins-values disponibles et de l’existence d’autres revenus du capital la même année.
Le PFU regroupe un impôt sur le revenu de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 30 % au total, avec une application simple et souvent compétitive. Le barème progressif remplace les 12,8 % par ta tranche de 0 %, 11 %, 30 %, 41 % ou 45 %, tout en conservant les 17,2 % de prélèvements sociaux, et une part de la CSG devient déductible l’année suivante, ce qui allège légèrement le coût effectif.
Quand le barème peut battre le PFU
Si tes revenus sont modestes et que ta TMI est à 0 %, tu ne paies que les 17,2 % de prélèvements sociaux, ce qui reste plus avantageux que les 30 % du PFU. Avec une TMI de 11 % et des gains limités, le coût total tourne autour de 28,2 % grâce à la CSG partiellement déductible, ce qui peut rendre le barème plus intéressant que le PFU. Si tu as des moins-values importantes sur des actifs numériques, elles s’imputent sur tes plus-values et se reportent sur les années suivantes ; si le barème ramène ton impôt sur le revenu à zéro, le PFU ne t’apporte aucun bénéfice.
Quand le PFU reste le réflexe gagnant
Si ta TMI atteint 30 % ou davantage, l’addition monte autour de 47,2 % voire plus, ce qui rend le PFU généralement plus intéressant. Lors d’une année avec beaucoup de dividendes ou d’intérêts, l’option pour le barème étant globale, elle peut alourdir l’imposition de ces revenus en plus de tes gains crypto. Si tu privilégies la simplicité et la prévisibilité, le PFU limite les calculs et réduit le risque de mauvaise surprise.
Mini cas chiffrés pour décider vite
Pour un gain crypto de 2 000 €, le PFU conduit à 600 € d’impôt et de prélèvements sociaux. Avec l’option pour le barème, une TMI à 0 % aboutit à environ 344 €, soit les seuls prélèvements sociaux, avantage net. Avec une TMI à 11 % le coût tourne autour de 564 € avant la prise en compte de la déductibilité partielle de la CSG, l’écart avec le PFU restant limité. Avec une TMI à 30 % on atteint environ 944 €, choix défavorable face au PFU.
Garde en tête que l’option barème se fait au moment de la déclaration et vaut pour toute l’année, sans retour en arrière. Les moins-values sur actifs numériques s’imputent sur les plus-values de même nature et se reportent sur les années suivantes, d’où l’importance de tracer chaque opération. Intègre aussi les frais d’acquisition et de cession, qui réduisent la base imposable quel que soit le régime retenu.
Comparer PFU et Barème
Estimation pédagogique. L’option barème impacte aussi intérêts et dividendes.
PFU 30 %
Meilleur choixBarème progressif
Meilleur choixMal calculer ses plus-values faute de traçabilité
La fiscalité crypto repose sur une logique de portefeuille global. Chaque vente en euros prélève une part de ton capital initial proportionnelle à la valeur totale de tes actifs numériques au moment de la cession. La plus-value correspond à ce qui dépasse cette part de capital. C’est simple sur le papier, exigeant dans la pratique sans dossiers propres et datés.
Le calcul s’appuie sur une formule officielle. Plus-value = Prix de cession − [Prix total d’acquisition du portefeuille × (Prix de cession ÷ Valeur globale du portefeuille au jour de la cession)]. Le “prix total d’acquisition” additionne tous les achats en monnaie légale et, le cas échéant, la valeur des biens ou services fournis en contrepartie. La “valeur globale du portefeuille” regarde tous tes actifs numériques au moment où tu vends.
Sans traçabilité, les erreurs se multiplient. On oublie des frais, on confond la valeur du portefeuille au jour J avec un instantané pris la veille, on perd des relevés d’exchange. Résultat : plus-value surestimée, impôt plus lourd, et incapacité à répondre à une demande de justificatifs.
Le seuil de 305 € joue un rôle de coupe-file. Si la somme des prix de cession de l’année reste à 305 € ou moins pour le foyer fiscal, on est exonéré ; au-delà, toutes les cessions de l’année deviennent imposables et on applique la formule.
Les moins-values se compensent seulement avec les plus-values de la même année. Il n’y a pas de report sur les années suivantes pour les actifs numériques. Soigne donc le suivi intra-annuel.
Bon réflexe au quotidien. Conserver facture et hash des transactions, noter la valeur totale du portefeuille à chaque vente en euros, archiver les frais tels qu’affichés par la plateforme, synchroniser les historiques d’API, exporter en CSV de temps en temps. Cette hygiène comptable te protège et simplifie la déclaration.
Assistant photo finish du portefeuille
Entre les valeurs au moment exact de la cession. Calcul immédiat et cumul annuel.
Cumul annuel des cessions
| Date | Montant (€) | Action |
|---|
Ignorer les revenus issus du staking, mining, airdrops ou NFT
Beaucoup déclarent seulement les ventes en euros et laissent de côté les revenus générés par l’écosystème. Résultat, assiette incomplète, régularisation douloureuse. La clé est de bien qualifier l’opération et tracer la valeur au bon moment.
Staking et lending
Les récompenses reçues ne sont pas une simple revente. Elles augmentent le stock de jetons.
Le bon réflexe est de noter la quantité et la valeur de marché au moment de la réception, puis décider du traitement au regard des règles en vigueur pour les particuliers. À la revente, la plus-value se calcule à partir de cette base documentaire. Oubli de traçabilité = base à zéro = plus-value gonflée.
Exemple simple. Tu stakes 1 ETH pendant l’année et reçois 0,05 ETH en plusieurs lots. Tu consignes chaque lot avec date et cours. Le jour où tu vends 0,05 ETH contre euros, tu peux justifier la valeur de référence des récompenses vendues. Sans journal, la valeur d’acquisition retenue risque d’être considérée nulle et l’impôt grimpe.
Mining
Le minage crée un revenu au fil des blocs. Il faut valoriser à la réception et tenir un registre technique : pool, hash, wallet, date, quantité, frais d’électricité si tu les suis. Lors de la revente des coins minés, on évite la double taxation en utilisant la valeur déjà comptabilisée comme base.
Airdrops et “claim” de tokens
Tous les airdrops ne se ressemblent pas. Certains sont promotionnels, d’autres conditionnés à une activité. Dans tous les cas, journaliser la date, le nombre de tokens et la valeur observable protège ta future déclaration. À la revente, tu relies chaque sortie à ses entrées documentées.
NFT
Deux cas se présentent. Si tu crées et vends tes propres œuvres, on se rapproche d’une activité de création, avec un traitement qui peut relever de revenus professionnels selon ta situation. Si tu achètes puis revends, tu agis comme collectionneur et l’on applique plutôt la mécanique des plus-values sur actifs numériques. La frontière n’est pas stricte, elle dépend de l’intensité de l’activité, des moyens engagés et de la récurrence des opérations. Sans traçabilité solide, difficile de défendre l’un ou l’autre devant l’administration.
Points qui font souvent dérailler une déclaration
Certaines plateformes convertissent automatiquement les rewards en stablecoin. À chaque conversion, tu crées potentiellement une cession imposable, détail à surveiller dans l’historique. Côté frais, s’ils ne sont pas conservés (réseau, pool, plateforme), la base imposable gonfle mécaniquement et tu paies trop. Les bridges et les wrappers ne sont pas systématiquement imposables, mais ils changent la valeur totale du portefeuille, celle qui sert au prorata lors d’une vente en euros. Enfin, des distributions éparpillées sur plusieurs wallets sans consolidation créent des trous dans l’historique et mènent à des calculs incohérents. Centralise tout, valorise au bon moment, archive les preuves.
Assistant de qualification
Choisis le type d’opération. Le module indique quoi tracer et quelles preuves garder.
Sélectionne une carte
Le module affiche ici quoi noter, comment valoriser et quoi archiver.
Preuves à garder
Info pédagogique. Ce module n’est pas un conseil fiscal personnalisé.
Éviter l’addition salée
La déclaration crypto devient simple dès que la méthode est claire. Déclare tes comptes étrangers chaque année, ne mélange pas cession en euros et échanges entre cryptos, choisis PFU ou barème en fonction de ta tranche et de tes autres revenus, calcule tes plus-values avec un portefeuille bien tracé, n’oublie aucun revenu Web3 comme le staking, le mining, les airdrops ou les ventes NFT.
La règle d’or reste la même. Un journal propre, des justificatifs datés, et une valorisation faite au bon moment. C’est ce qui fait la différence entre une déclaration maîtrisée et une régularisation coûteuse.





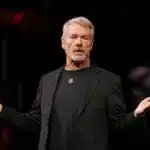
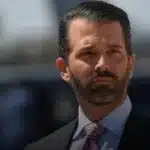

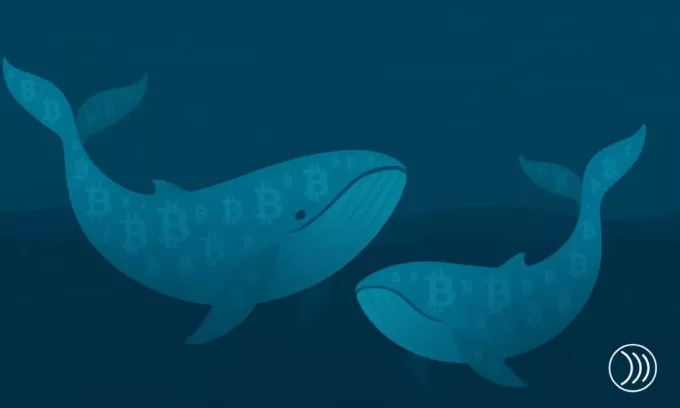






Laisser un commentaire